Carcajou

Description de l’espèce
Voici un rapport des progrès accomplis en matière de protection et de rétablissement du carcajou (Gulo gulo) en Ontario de 2007 à 2020, selon la politique de rétablissement de l’Ontario propre à l’espèce. Le présent rapport répond à l’exigence législative d’un examen des progrès réalisés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD ou « la Loi »). Le carcajou est inscrit comme espèce menacée sur la Liste des espèces en péril en Ontario (Liste des EEPEO) en vertu de la LEVD.
Le carcajou est classé parmi les espèces en péril depuis 2004. L’espèce était auparavant classée comme une espèce menacée et a été inscrite comme telle lors de l’entrée en vigueur de la LEVD en juin 2008.
Depuis 2008, le carcajou est protégé par une interdiction de le tuer, le blesser, le harceler, le capturer ou le prendre.
De plus, l’habitat du carcajou est protégé de l’endommagement et de la destruction depuis 2013.
La politique de rétablissement du carcajou, aussi appelée la Déclaration du gouvernement en réponse au programme de rétablissement (la Déclaration) a été publiée en 2016 et comprend l’objectif de rétablissement du gouvernement pour cette espèce, ainsi que les mesures et les priorités qu’il entend mener ou appuyer pour l’atteinte cet objectif. La Déclaration tient compte des avis scientifiques fournis dans le cadre du programme de rétablissement, lors de l’élaboration des mesures de rétablissement de l’espèce. Comme le prévoit la loi, l’objectif de cet examen est de rendre compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures de protection et de rétablissement prévues par la Déclaration. L’examen peut également aider à relever les possibilités d’ajustement et d’adaptation de la mise en œuvre des mesures de protection et de rétablissement pour atteindre l’objectif de rétablissement de l’espèce.
De plus amples informations sur le carcajou, y compris les menaces auxquelles il est confronté et les mesures prises en matière de protection et de rétablissement de cette espèce, sont accessibles sur la page Web du gouvernement de l’Ontario consacrée au carcajou. Un résumé des progrès accomplis en matière de protection et de sauvegarde du carcajou, ainsi qu’une mise à jour annuelle du programme élargi des espèces en péril (p. ex., l’introduction du rapport d’évaluation des progrès 2021) sont disponibles sur la page Examen des progrès accomplis dans la protection et le rétablissement des espèces en péril en Ontario.
Aperçu : Progrès accomplis dans la protection et le rétablissement du carcajou
Progrès accomplis dans l’atteinte de l’objectif de rétablissement
- L’objectif de rétablissement énoncé dans la Déclaration du gouvernement en réponse au programme de rétablissement pour le carcajou en Ontario consiste à « maintenir la répartition actuelle en Ontario et à favoriser l’accroissement naturel de l’abondance et de l’aire de répartition de la population ».
- Des progrès ont été accomplis relativement à la mise en œuvre de tous les objectifs de rétablissement menés par le gouvernement et de la majorité des mesures connexes. Voici quelques exemples de progrès :
- recherche et promotion de pratiques exemplaires de gestion pour le piégeage des animaux à fourrure qui minimisent les préjudices causés au carcajou grâce aux efforts déployés par la Fédération ontarienne des gestionnaires d’animaux à fourrure (FOGAF), le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts (DNMRNF) et la Wildlife Conservation Society (WCS) Canada avec l’appui financier du Programme d’intendance des espèces en péril
- élaboration de plans communautaires d’aménagement du territoire et collecte de connaissances écologiques traditionnelles sur le carcajou grâce à des efforts déployés en partenariat avec les collectivités des Premières Nations du Grand Nord
- travail approfondi de la WCS Canada dans le cadre du suivi et de la surveillance du carcajou tout en recueillant des données sur l’utilisation de l’habitat
- Il est recommandé de poursuivre les efforts afin d’appliquer toutes les mesures de la Déclaration et, en particulier, d’élaborer, de mettre en œuvre et de mettre à jour, au besoin, les pratiques exemplaires de gestion afin de réduire les effets des activités de développement, comme l’exploitation minière, l’infrastructure et le développement énergétique sur et autour des tanières du carcajou.
Occurrences et répartition
- Le carcajou est largement répandu dans le nord de l’Ontario, avec une aire de répartition estimée de 117 900 kilomètres carrés d’après des observations récentes.
- Le Centre d’information sur le patrimoine naturel (CIPN) a reçu plus de 6 900 signalements du carcajou, dont plus de 6 700 observations depuis sa première inscription en 2004. Les signalements sont basés sur des observations effectuées entre 1954 et 2020, une majorité importante d’observations résultant des relevés délibérés du carcajou.
Depuis 2008, l’espèce a été observée dans des emplacements où sa présence n’était pas connue auparavant et dans des emplacements que l’on croyait historiques. Sur la base d’informations actualisées, on estime que la répartition actuelle de l’espèce a augmenté de 90 400 kilomètres carrés par rapport à ce qui était connu en 2008. Cette augmentation de sa répartition estimée peut être partiellement attribuée à un effort de recherche accru et à de nouvelles observations dans des zones où le carcajou était précédemment présent. Toutefois, une surveillance récente indique que l’espèce a étendu son aire de répartition principale au cours des dernières années, et l’augmentation de la répartition estimée peut refléter cette expansion de l’aire de répartition, en particulier le long de la périphérie orientale de l’aire de répartition de l’espèce.
Projets d’intendance soutenus par le gouvernement
- À l’aide du Programme d’intendance des espèces en péril, le gouvernement de l’Ontario a permis à ses partenaires d’intendance de réaliser 17 projets (en fournissant un financement de 1 001 751 $) qui ont contribué à la protection et au rétablissement du carcajou. Six de ces projets (446 650 $) portaient exclusivement sur l’espèce et les 11 autres projets (555 101 $) portaient sur plusieurs espèces en péril, y compris le carcajou.
- Le soutien financier du gouvernement a aidé les partenaires d’intendance à faire participer 249 personnes qui ont consacré bénévolement 4 930 heures de leur temps à des activités de protection et de rétablissement de plusieurs espèces en péril, dont le carcajou. La valeur estimée de ces participations bénévoles, à laquelle s’ajoutent le financement et l’appui non financier, s’élève à 1 069 515 $.
- Les partenaires d’intendance ont déclaré avoir procédé à une sensibilisation à plusieurs espèces en péril, dont le carcajou, auprès de 15 449 personnes.
- Grâce au Fonds de recherche sur les espèces en péril de l’Ontario, le gouvernement a également accordé un financement à six projets (75 300 $) afin d’effectuer des recherches sur la collecte d’informations génétiques sur les populations de carcajou, l’élaboration de protocoles de surveillance de cette espèce et l’amélioration de la compréhension de sa répartition.
Soutien des activités humaines tout en assurant le soutien adéquat du rétablissement de l’espèce
- Le gouvernement de l’Ontario a délivré sept permis pour cette espèce : Six de ces permis étaient des permis de « possession à des fins scientifiques ou éducatives » (alinéa 9 [5] a), et un était un permis « pour raison d’avantage social ou économique » (alinéa 17 [2] d).
- Vingt-deux activités ont été enregistrées pour l’espèce. Les activités ont été enregistrées sous« Exploration minière initiale » (article 23.10), « Espèces nouvellement inscrites et en transition » (article 23.13), « Activités de protection et de rétablissement des espèces » (article 23.17), « Menaces à la santé ou à la sécurité humaine » (article 23.18) et « Avis de piégeage accidentel » (article 23.19)en vertu du Règlement de l’Ontario 242/08 de la LEVD.
Rapport des progrès accomplis dans la protection et le rétablissement du carcajou
Objectif de rétablissement
L’objectif de rétablissement du gouvernement pour le carcajou est de maintenir la répartition actuelle en Ontario et de favoriser l’accroissement naturel de l’abondance et de l’aire de répartition de la population.
La mise en œuvre de mesures dirigées et soutenues par le gouvernement démontre les progrès accomplis pour atteindre les objectifs souhaités et le but du rétablissement défini dans la Déclaration.
Progrès dans la mise en œuvre des mesures dirigées par le gouvernement
Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre de la plupart des mesures dirigées par le gouvernement et recensées dans la Déclaration. Les mesures courantes que le gouvernement doit mener pour atteindre l’objectif de rétablissement d’une espèce sont les suivantes :
- Encourager la soumission de données sur le carcajou à l’entrepôt de données central du gouvernement au Centre d’Information sur le patrimoine naturel.
- Protéger le carcajou et son habitat grâce au LEVD.
- Renseigner les autres organismes et autorités qui prennent part aux processus de planification et d’évaluation environnementales quant aux exigences de protection prévues à la LEVD.
En outre, le gouvernement a directement entrepris les mesures suivantes propres à l’espèce :
Guide de gestion forestière pour la conservation de la biodiversité à l’échelle du peuplement et du site
En 2010, le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Ressources naturelles et des Forêts (DNMRNF) (auparavant ministère des Ressources naturelles et des Forêts) a élaboré le Guide de gestion forestière pour la conservation de la biodiversité à l’échelle du peuplement et du site (Guide à l’échelle du peuplement et du site).
Ce guide fournit des directives obligatoires aux gestionnaires forestiers en matière d’élaboration de prescriptions opérationnelles pour les opérations forestières sur les terres de la Couronne en Ontario, y compris l’élaboration d’un plan de gestion du site de tanière du carcajou, tout en assurant le maintien et la santé à long terme de la forêt gérée. Le document fournit une orientation générale et détaillée pour conserver la biodiversité ainsi que des normes, des directives et des pratiques exemplaires de gestion particulières pour des secteurs préoccupants qui s’appliquent aux opérations de récolte, de renouvellement et d’entretien, ainsi qu’à la construction, l’utilisation et l’entretien des routes, des débarcadères et des fosses à agrégats forestiers. L’orientation du Guide à l’échelle du peuplement et du site est mise en œuvre conjointement avec le guide de gestion forestière pour les paysages de la forêt boréale (Forest Management Guide for Boreal Landscapes), qui énonce également des exigences plus larges en matière d’habitat du carcajou (par exemple : grandes parcelles et calendrier dynamique de l’habitat du caribou). L’élaboration de ces guides a été entreprise par le DNMRNF, de nombreux partenaires de l’industrie forestière et des groupes de parties prenantes concernées, y compris des organisations environnementales non gouvernementales.
Le Guide à l’échelle du peuplement et du site fournit une orientation générale et détaillée et des secteurs préoccupants propres aux sites de protection des espèces en péril et de leurs habitats, avec une orientation particulière pour le carcajou et son habitat. Cela comprend des informations sur le maintien de l’habitat du carcajou dans les zones forestières gérées et la gestion des tanières identifiées de cette espèce. Par exemple, le Guide à l’échelle du peuplement et du site identifie les caractéristiques qui doivent être considérées comme faisant partie d’une tanière de carcajou, y compris un secteur préoccupant autour de ces caractéristiques. Des normes et des directives sont ensuite données sur la manière dont ces caractéristiques doivent être protégées pendant les opérations et sur ce qui doit être inclus dans un plan de gestion du site de tanière.
L’utilisation obligatoire de guides de gestion forestière approuvés dans le cadre de la planification de la gestion forestière est permise par le Manuel de planification de la gestion forestière et le Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture qui sont tous deux réglementés par la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. Les guides de gestion forestière sont réévalués au moins une fois tous les dix ans et révisés si nécessaire sur la base de nouvelles données scientifiques pertinentes, de l’expérience opérationnelle ou de modifications législatives ou politiques.
Mesure de lutte contre le changement climatique
L’Ontario a joué un rôle important dans la lutte contre le changement climatique et a pris des mesures importantes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et les émissions de la province ont considérablement diminué depuis 2005. Le gouvernement provincial continue à œuvrer pour une approche équilibrée en matière de réduction des émissions et se prépare à faire face aux effets du changement climatique. Notre plan de lutte contre le changement climatique et de protection de notre air, notre terre et notre eau propose des moyens efficaces et abordables pour lutter contre le changement climatique et renforcer la résilience climatique, sans taxe sur l’émission carbonique.
L’Ontario a lancé une vaste évaluation provinciale intersectorielle des effets du changement climatique qui utilisera les meilleures données scientifiques et informations disponibles pour mieux comprendre où et comment le changement climatique aura un impact en Ontario. Un groupe consultatif sur le changement climatique a également été créé et un plan a été élaboré sur la manière dont il fournira des conseils d’experts sur la mise en œuvre des mesures recommandées par la province en matière de changement climatique.
Le plan provincial de lutte contre le changement climatique doit être un document à caractère évolutif et s’adapter pour répondre aux priorités environnementales au fur et à mesure que de nouvelles informations, idées et innovations apparaissent.
Planification communautaire de l’utilisation des sols
La planification communautaire de l’utilisation des terres est un processus conjoint entre les Premières Nations et Ontario visant à prendre des décisions consensuelles sur les terres ouvertes au développement et celles qui doivent être protégées dans le Grand Nord d’Ontario. Tout au long du processus de planification, les Premières Nations apportent leurs connaissances traditionnelles, leur relation historique avec la terre et les intérêts de la communauté pour éclairer les décisions concernant le développement et la protection économiques. L’Ontario contribue aux intérêts provinciaux liés au développement économique et à la protection de l’environnement, fournit des informations cartographiques et scientifiques, et assure des possibilités de participation du public et des intervenants. Chaque plan communautaire d’aménagement du territoire documente les résultats du processus de planification.
Les plans définissent les zones d’utilisation du sol et attribuent une désignation à chaque zone. Les désignations sont utilisées pour définir les objectifs généraux et les priorités d’une zone, ainsi que les utilisations du sol qui sont autorisées ou non. Les trois désignations que les équipes de planification utilisent dans leurs plans sont les suivantes :
- zones dédiées aux fins de protection (ZDFP)
- zones de gestion valorisée (ZGV)
- zones d’utilisation générale (ZUG)
Les équipes d’aménagement appliquent la désignation de zone dédiée aux fins de protection lorsqu’il y a un intérêt à préserver des zones libres de tout développement industriel, en raison de leur valeur écologique ou culturelle sensible ou considérable. Comme le précise la Loi de 2010 sur le Grand Nord, certains aménagements, utilisations des terres et activités ne peuvent être réalisés dans une zone protégée, notamment : la prospection, le jalonnement de claims miniers ou l’exploration minière, l’ouverture d’une mine, la récolte commerciale de bois d’œuvre et l’exploration ou la production de pétrole et de gaz.
La protection d’une série d’espèces et de valeurs sauvages, y compris le carcajou, est assurée par l’intégration d’informations et de connaissances (y compris les connaissances écologiques traditionnelles et les données scientifiques), grâce aux désignations de zones dédiées aux fins de protection et à l’orientation de la gestion des activités futures dans les zones de gestion valorisée et les zones d’utilisation générale. L’objectif de la conception de ces zones d’utilisation des terres est de prendre en compte les habitats, les zones à forte utilisation et les couloirs de déplacement qui s’étendent à l’intérieur et au-delà d’une zone de planification vers les zones protégées adjacentes.
Les équipes d’aménagement tiennent compte d’une large perspective paysagère pour déterminer comment préserver un habitat important pour une série d’espèces, incluant le carcajou. La conception de zones protégées plus vastes qui interdisent certaines activités garantit le maintien de l’habitat, contribue à minimiser la fragmentation et aide à protéger les espèces à des moments cruciaux de l’année. La prise en compte de la connectivité des zones dédiées aux fins de protection au sein d’une zone d’aménagement et entre les zones d’aménagement des communautés adjacentes contribue au maintien des valeurs écologiques et culturelles.
Une fois qu’un plan est mis en place, toutes les activités doivent être conformes à l’orientation du plan (c’est-à-dire aux utilisations du sol qui sont autorisées et interdites, telles que définies dans le plan). En outre, les plans comprennent généralement des orientations pour les utilisations autorisées du sol. Afin de s’assurer que toutes les parties sont au courant de l’orientation de l’utilisation des terres, les plans approuvés sont affichés sur le site Web du gouvernement d’Ontario et ajoutés à l’ adresse en ligne Atlas des politiques d’utilisation des terres de la Couronne.
En date de janvier 2021, cinq collectivités des Premières Nations ont collaboré avec Ontario et ont terminé leurs plans communautaires d’aménagement du territoire (Pikangikum, Cat Lake, Slate Falls, Pauingassi, Little Grand Rapids). Ces plans ont été approuvés par la Première nation et le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Ressources naturelles et des Forêts aux termes de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. Les plans actuellement approuvés ont des zones d’aménagement dont la taille varie d’environ 1 400 kilomètres carrés à 14 500 kilomètres carrés, et désignent de 34 % à 100 % de leurs zones d’aménagement comme des zones dédiées aux fins de protection.
Neuf autres collectivités des Premières Nations ont terminé leur mandat, notamment Marten Falls, Eabametoong et Mishkeegogamang, Webequie, Wawakapewin, McDowell Lake, le lac de Constance, Kashechewan et Weenusk. Un mandat est une entente entre les Premières Nations et le gouvernement de l’Ontario qui établit les objectifs et le processus d’élaboration d’un plan communautaire d’aménagement du territoire.
Le gouvernement de l’Ontario reste déterminé à collaborer avec les collectivités dans le cadre du processus communautaire d’aménagement des terres afin de déterminer et de protéger les zones de valeur culturelle et écologique, tout en maintenant les possibilités de développement économique durable qui profitent aux Premières Nations.
Pratiques exemplaires de gestion pour le piégeage des animaux à fourrure
Des efforts de collaboration ont été déployés pendant plusieurs années entre les trappeurs, la Fédération ontarienne des gestionnaires d’animaux à fourrure (FOGAF), le DNMRNF et la Wildlife Conservation Society (WCS) Canada, avec l’appui financier du Programme d’intendance des espèces en péril, afin de rechercher et de promouvoir les pratiques exemplaires de gestion pour le piégeage des animaux à fourrure qui minimisent les préjudices causés au carcajou. Grâce à ces efforts, le document Best Management Practices to Avoid Wolverine a été élaboré et est actuellement hébergé sur le site Web de la FOGAF. Ce document est promu comme un outil éducatif pour les trappeurs qui fournit un aperçu de la biologie, du comportement, de l’habitat, de l’aire de répartition et du statut du carcajou. Il indique ce qu’il faut faire si un carcajou vivant se trouve dans un piège et comment éviter d’endommager les pièges et les lieux de piégeage (par exemple, pour la martre); il décrit les pratiques exemplaires pour éviter de capturer accidentellement des carcajous, y compris des conseils sur le type d’appât, le placement de l’appât et les types de pièges et de dispositifs de piégeage.
En outre, le manuel d’instruction des trappeurs de l’Ontario comprend une section complète sur la façon d’éviter la capture du carcajou. Ce manuel doit être utilisé par les trappeurs qui participent au cours sur la récolte, la gestion et la conservation des fourrures, une formation obligatoire de 40 heures à suivre avant de pouvoir obtenir un permis de piégeage en Ontario. Les éléments pertinents de ce manuel d’instruction comprennent des informations sur la manière de reconnaître la présence du carcajou dans une zone de piégeage, de sélectionner les pièges pour minimiser les captures accidentelles et de signaler les observations de l’espèce.
Occurrences et répartition
Le carcajou est largement répandu dans le nord de l’Ontario. Compte tenu de la vaste répartition de l’espèce et du volume élevé de données soumises, les informations sur les occurrences de l’espèce ont été évaluées à l’échelle du paysage en utilisant des « carrés » de grille de 10 kilomètres sur 10 kilomètres afin d’estimer la répartition de l’espèce. Les carrés ont été utilisés pour estimer où l’espèce a été observée récemment (c’est-à-dire au cours des 20 dernières années) et où elle est considérée comme historique
En utilisant cette approche, l’espèce a été récemment observée dans 1 179 carrés. Il reste 22 autres carrés où des observations historiques ont eu lieu. Cela équivaut à une aire de répartition éventuelle
Le CIPN a reçu plus de 6 900 signalements de carcajou, dont plus de 6 700 ont eu lieu depuis la première inscription de l’espèce en 2004. Les signalements sont basés sur des observations effectuées entre 1954 et 2020, une majorité importante d’observations résultant des relevés délibérés du carcajou. Sur la base des enregistrements effectués depuis 2008, l’espèce a été observée dans des endroits associés à 904 carrés dans lesquels sa présence n’était pas connue auparavant, et la présence de l’espèce a été reconfirmée dans 145 autres carrés.
Cet élargissement de la répartition estimée de l’espèce peut être, en partie, le résultat d’un effort de recherche accru et représenter une meilleure connaissance de la répartition de l’espèce dans les endroits où elle était présente auparavant. Toutefois, de récents efforts de surveillance et de recherche indiquent que l’espèce s’est étendue vers l’est dans des zones périphériques et qu’elle a récupéré des parties de son aire de répartition des années 1950 (équipe ontarienne de rétablissement du carcajou, 2013). Par conséquent, bon nombre des occurrences récentes dans des carrés où l’espèce n’avait pas été documentée auparavant peuvent représenter une expansion de l’aire de répartition, en particulier le long de la périphérie orientale de son aire de répartition.
La Déclaration prévoit d’encourager le signalement des observations de cette espèce en tant que mesure gouvernementale. La soumission d’observations d’espèces permet d’accroître nos connaissances des endroits où elles sont présentes et peut contribuer grandement à l’évaluation de la viabilité des populations de l’espèce. Les particuliers sont encouragés à signaler, ou peuvent être tenus de le faire par une autorisation ou une approbation, les observations du carcajou ou de toute autre espèce en péril à la CIPN afin qu’elles soient intégrées au répertoire provincial des observations. Actuellement, les observations peuvent être soumises au CIPN par le biais du projet sur les espèces rares en Ontario, dans iNaturalist.
-
6 700signalements de ces espèces ont été communiqués au CIPN depuis 2004
Projets d’intendance soutenus par le gouvernement
Le soutien financier de partenaires pour la mise en œuvre d’activités de protection et de rétablissement du carcajou constitue une importante mesure menée par le gouvernement qui est mentionnée dans la Déclaration relative à l’espèce. À l’aide du Programme d’intendance des espèces en péril, le gouvernement a appuyé 17 projets (1 001 751 $) visant à contribuer à la protection et au rétablissement du carcajou. Six de ces projets (453 460 $) portaient exclusivement sur l’espèce et les 11 autres projets (555 101 $) portaient sur plusieurs espèces en péril, y compris le carcajou. En plus du financement gouvernemental, les partenaires se concentrant exclusivement sur le carcajou ont signalé qu’ils avaient réussi à obtenir des fonds supplémentaires (732 087 $) d’autres sources, tout comme les partenaires dont les projets visaient à bénéficier à plusieurs espèces en péril, y compris le carcajou (337 428 $). Ces montants comprennent l’appui non financier prenant la forme du temps et de l’expertise que les bénévoles ont consacrés aux projets.
Les partenaires d’intendance ont indiqué que le soutien financier de la province leur a permis d’obtenir l’appui non financier de 97 personnes qui ont consacré bénévolement 2 122 heures de leur temps à des activités de protection et de rétablissement axées exclusivement sur le carcajou pour une valeur estimée à 47 087 $. Par ailleurs, 152 personnes ont consacré bénévolement 2 808 heures de leur temps à des activités de protection et de rétablissement de plusieurs espèces en péril, dont le carcajou, pour une valeur estimée à 148 847 $. En outre, les partenaires d’intendance ont indiqué avoir fourni une sensibilisation ciblée sur le carcajou à 15 449 personnes et une sensibilisation à de multiples espèces en péril, y compris le carcajou, à 10 892 personnes.
Le gouvernement soutient également les promoteurs qui effectuent des recherches pour combler les importantes lacunes dans les connaissances sur les espèces en péril. Grâce au Fonds de recherche sur les espèces en péril de l’Ontario, le gouvernement a accordé un financement à six projets (75 300 $) afin d’effectuer des recherches sur la collecte d’informations génétiques sur les populations de carcajou, l’élaboration de protocoles de surveillance de cette espèce et l’amélioration de la compréhension de sa répartition. Les travaux soutenus par le Fonds de recherche sur les espèces en péril ont conduit à la publication d’articles de recherche examinés par les pairs, notamment :
- Ray, J. C., L. G. Poley, A. J. Magoun, C. B. Chetkiewicz, M. Southee, N. Dawson, et C. Chenier. 2018. « Modelling broad-scale wolverine occupancy in a remote Boreal region using multi-year aerial survey data » Journal of Biogeography 45 : 1478-1489.
Les paragraphes suivants mettent en évidence deux projets appuyés par le Programme d’intendance des espèces en péril ainsi que les mesures correspondantes soutenues par le gouvernement aux fins de rétablissement de l’espèce.
Projet de surveillance du carcajou de la Wildlife Conservation Society Canada
En 2018, le chercheur de la WCS Canada, Matthew Scrafford, a commencé à étudier le carcajou dans la région de Red Lake, dans le nord-ouest de l’Ontario, financé en partie par le Programme d’intendance des espèces en péril du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP). Le projet a été financé pour trois ans et la dernière année de travail est maintenant terminée. Pour mener à bien ce projet, la WCS a travaillé et collaboré avec de multiples partenaires, notamment des trappeurs locaux, et a obtenu un financement supplémentaire de la part de plusieurs partenaires extérieurs, dont la W. Garfield Weston Foundation, Domtar et Evolution Mining.
Entre 2018 et 2020, environ 40 carcajous ont été piégés ou échantillonnés par des moyens passifs (échantillons de poils et pièges à caméra) dans toute la zone d’étude (6 500 kilomètres carrés). En outre, 28 carcajous au total ont été équipés de colliers émetteurs GPS afin de comprendre leur utilisation de l’habitat et leur choix de site pour leur tanière. Quatre sites de tanières de carcajou ont été localisés, et cette information est utilisée pour mettre à jour les plans de gestion des sites de tanières qui sont en cours d’élaboration par le DNMRNF, Domtar (forêt du lac Trout) et Red Lake Forest Management Company Ltd. (forêt du lac Red) avec l’aide précieuse de la WCS Canada à des fins de planification de gestion forestière. Les résultats des colliers émetteurs GPS ont montré que la taille des territoires (jusqu’à 4 700 kilomètres carrés) des carcajous munis de colliers était jusqu’à 15 fois supérieure à ce que suggéraient les études antérieures (300 kilomètres carrés) et que les carcajous semblent occuper la région du lac Red à une faible densité (3 à 5 carcajous par 1 000 kilomètres carrés). Les résultats de l’étude ont également confirmé que la population de carcajous du lac Red se reproduit.
La dernière année, ce projet s’est concentré sur le suivi des carcajous femelles, en ciblant le piégeage vivant dans les zones où l’on soupçonne l’arrivée de nouvelles femelles, et en continuant à utiliser des pièges à caméra installés sur les routes pour étudier plus en détail les besoins en matière d’habitat et le choix des sites de tanière. Des travaux ont également été réalisés pour améliorer les modèles d’habitat afin de prendre en compte l’utilisation des routes par les loups et les relations connexes à l’utilisation de l’habitat du carcajou.
Ce projet démontre des progrès dans plusieurs mesures hautement prioritaires, telles que la réalisation d’un inventaire et le suivi du carcajou, et la réalisation de recherches sur les besoins et l’utilisation de l’habitat de l’espèce. Les données recueillies dans le cadre de ce projet peuvent également contribuer à des progrès futurs pour des mesures telles que le développement de modèles au niveau du paysage pour le carcajou en Ontario.
Vérification sur le terrain des connaissances écologiques traditionnelles
Au cours des deux années suivantes, Bamaji Air Inc. a réalisé un projet au nom de la Première Nation de Cat Lake et de la Première Nation de Slate Falls pour recueillir et vérifier sur le terrain les connaissances écologiques traditionnelles relatives à certaines espèces en péril sur leurs territoires. Le projet visait à combler d’importantes lacunes de connaissances quant à la collecte, à la sensibilisation et à l’intégration des connaissances écologiques traditionnelles pour le carcajou et d’autres espèces en péril dans la zone d’aménagement du territoire des Premières Nations de Cat Lake et de Slate Falls.
Des événements publics ont été organisés afin d’impliquer la communauté dans le projet et de trouver des membres de la communauté prêts à participer à des entretiens visant à repérer les endroits susceptibles de contenir l’habitat du carcajou, avec un accent particulier sur les sites de tanières. Sur la base des informations recueillies lors des entretiens, des endroits ont été choisis pour l’installation de stations de caméras de terrain afin de recueillir des photos de tous les carcajous qui visitent la station. Au cours de cette étape du projet, le personnel du DNMRNF s’est rendu sur le site pour fournir des conseils et indiquer les méthodologies appropriées pour l’installation et le positionnement des caméras servant à la collecte des données. Les stations étaient destinées à être utilisées au-delà de la durée du projet financé afin de continuer à recueillir des données sur la présence du carcajou sur les territoires des Premières Nations.
Ce projet démontre que des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de plusieurs mesures en faveur de cette espèce, notamment en réalisant l’inventaire et la surveillance du carcajou, en encourageant le signalement, le partage et le transfert des connaissances écologiques traditionnelles sur le carcajou, en coordonnant les efforts de partage des informations entre les collectivités et les organisations autochtones et en travaillant conjointement avec les collectivités des Premières Nations grâce à la planification communautaire de l’aménagement du territoire.
Programme d’intendance des espèces en péril
-
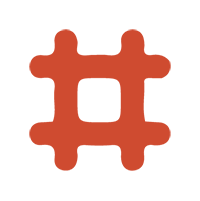 17
17projets pour le carcajou
-
 6
6projets pour le carcajou exclusivement
-
 555 101 $
555 101 $pour des projects visant plusieurs espèces, dont le carcajou
-
 453 460 $
453 460 $pour le carcajou exclusivement
-
 1 069 515 $
1 069 515 $en appui et financement supplémentaires
-
 249
249bénévoles
-
 4 930
4 930heures de bénévolat
-
 15 449
15 449personnes atteintes par la sensibilisation
Soutien aux activités humaines liées au rétablissement de l’espèce
L’octroi d’autorisations et la mise en place de conditions liées à ces autorisations constituent une mesure importante dirigée par le gouvernement dans le cadre de ses activités de soutien offert aux partenaires.
Sept permis ont été délivrés pour le carcajou depuis que l’espèce est protégée par la LEVD. Six de ces permis étaient des permis de « possession à des fins scientifiques ou éducatives » (alinéa 9 [5] a), et un était un permis « pour raison d’avantage social ou économique » (alinéa 17 [2] d).
Les permis délivrés pour la « possession ou le transport à des fins scientifiques ou éducatives » permettent aux promoteurs d’être en possession d’une espèce en péril pour des raisons approuvées. Chacun de ces permis délivrés devait permettre le transfert de carcajous capturés accidentellement pour être utilisés à des fins instructives par des écoles et des groupes de gestionnaires des animaux à fourrure.
Les permis « pour raison d’avantage social ou économique » autorisent un promoteur à mener une activité qui, autrement, serait contraire à la LEVD, tant que toutes les conditions du permis sont remplies. Avant de délivrer ce type de permis, le ministre doit demander l’avis d’une personne qui est un expert sur les effets que l’activité peut avoir sur l’espèce. Pour délivrer le permis, le ministre doit être d’avis que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario, que des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées et que des mesures raisonnables visant à réduire au minimum les effets néfastes sur les membres individuels de l’espèce sont requises par les conditions du permis.
En 2019, le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs a délivré un permis « pour raison d’avantage social ou économique », c’est-à-dire un permis en vertu de l’article 17(2)d) de la LEVD, à la Wataynikaneyap Power pour de multiples espèces en péril, y compris le carcajou. Le permis a été délivré dans le cadre de la construction d’une ligne de transport d’électricité dans le Grand Nord, qui permettrait de relier les collectivités de cette région au réseau électrique provincial et de réduire la dépendance à la production locale d’énergie au diesel.
Les conditions de ce permis comprennent notamment, sans s’y limiter :
- Assurer une formation appropriée à la manipulation et au travail avec des espèces en voie de disparition, le cas échéant
- Limiter l’accès aux zones d’habitat par la ligne de transmission et les routes d’accès requises
- Surveiller l’empreinte du projet sur le site pendant la construction
- Conserver la végétation dans les voies d’accès
- Restaurer les zones d’habitat et les voies d’accès
- Limiter le calendrier des activités aux périodes ayant le moins de répercussions sur les espèces en péril
- Mettre en œuvre un plan de gestion du bruit
- Afficher des panneaux indiquant la présence des espèces et les limites de vitesse
- Éviter les sites de tanières des espèces en péril, y compris ceux du carcajou
- Effectuer tous les contrôles et rapports requis
Toutes les conditions mentionnées doivent être respectées jusqu’à la fin des travaux du projet afin de minimiser les répercussions sur les espèces en péril et leur habitat. D’autres mesures bénéfiques ont été prises dans le cadre de ce projet :
- Éducation du public sur le projet et les mesures prises pour minimiser les répercussions
- Consultation des collectivités autochtones sur la conception et la mise en œuvre du projet
- Mise en œuvre d’un plan de restauration
- Achèvement d’un projet de recherche visant à améliorer les méthodes pour minimiser les prises accessoires de carcajou dans les lignes de piégeage
Vingt-deux activités susceptibles d’affecter le carcajou ou son habitat ont été enregistrées aux fins du Règlement de l’Ontario 242/08 en vertu de la LEVD. Huit activités ont été signalées sous « Exploration minière initiale » (article 23.10), deux sous « Espèces nouvellement inscrites et en transition » (article 23.13), trois sous « Activités de protection ou de rétablissement des espèces » (article 23.17), cinq sous « Menaces pour la santé ou la sécurité humaine » (article 23.18) et quatre sous « Avis de piégeage accidentel » (article 23.19). Aux termes de ces enregistrements, la personne enregistrée est tenue de respecter toutes les conditions du règlement, notamment :
- s’assurer que des mesures raisonnables sont prises pour réduire au minimum les effets négatifs de l’activité sur les espèces mentionnées dans le formulaire d’avis d’activité
- préparer un plan de mesures d’atténuation en se servant des meilleures informations disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences néfastes sur l’espèce
- signaler les observations de l’espèce au CIPN en utilisant le Formulaire de signalement d’une espèce en péril de l’Ontario
-
6possession à des fins scientifiques ou éducatives
-
1permis pour raison d’avantage social ou économique
-
22enregistrements
Progrès dans la mise en œuvre des mesures soutenues par le gouvernement
Les mesures appuyées et menées par le gouvernement sont organisées en fonction d’objectifs de rétablissement globaux. Des progrès ont été accomplis pour l’atteinte de tous les objectifs de rétablissement identifiés et la mise en œuvre d’une majorité des mesures connexes identifiées dans la Déclaration pour le carcajou.
Objectif : Accroître les connaissances sur la biologie, l’écologie, la répartition, la dynamique des populations, les menaces et l’utilisation de l’habitat du carcajou en Ontario.
- Mesure 1 (hautement prioritaire) – Procéder à l’inventaire et à la surveillance du carcajou, y compris l’intégration de la surveillance du carcajou aux programmes d’inventaire et de surveillance à grande échelle en cours (par exemple les relevés d’inventaire aérien des orignaux) et aux initiatives relatives aux espèces boréales en péril.
- Mesure 2 (hautement prioritaire) – Effectuer des recherches sur les besoins de l’espèce en matière d’habitat et sur son utilisation de l’habitat en Ontario.
- Mesure 3 – Encourager le signalement, le partage et le transfert des connaissances écologiques traditionnelles sur le carcajou, y compris les informations sur la répartition actuelle et historique de l’espèce et l’utilisation de son habitat. Coordonner ces efforts avec les autres espèces en péril présentes dans les mêmes zones.
- Mesure 4 – Élaborer, tester et mettre à jour des modèles à l’échelle du paysage pour le carcajou en Ontario afin de mieux comprendre et de prévoir les changements futurs dans les déplacements et la répartition de l’espèce.
- Mesure 5 – Coordonner les efforts et partager l’information entre les collectivités et organisations autochtones et d’autres territoires de compétence, tels que le gouvernement fédéral, le Manitoba et le Québec, afin de combler les lacunes de connaissances en Ontario.
- Mesure 6 – Encourager le signalement des données sur le carcajou au dépôt central du ministère au Centre d’information sur le patrimoine naturel.
Dans le cadre de cet objectif, des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre des mesures 1 et 2 grâce aux efforts du projet de surveillance du carcajou de la WCS Canada et à d’autres projets du Programme d’intendance des espèces en péril (PIEEP). Ces projets ont permis d’obtenir des informations précieuses sur le carcajou en Ontario grâce à l’inventaire des populations, à la collecte de données génétiques et à la documentation des zones d’habitat dans lesquelles se trouve cette espèce.
Des progrès ont été accomplis dans le cadre des mesures 3 et 5 grâce aux projets du Programme d’intendance des espèces en péril visant à recueillir et à partager les connaissances écologiques traditionnelles sur le carcajou et grâce à l’élaboration de plans communautaires d’aménagement du territoire rédigés en partenariat avec les collectivités des Premières Nations. Les informations recueillies dans le cadre de ces projets et utilisées pour élaborer les plans d’aménagement du territoire sont partagées au besoin avec les agences partenaires et d’autres territoires de compétences afin d’améliorer les avantages plus que compensatoires à l’espèce.
Des progrès initiaux ont été accomplis dans le cadre de la mesure 4 grâce à la collecte de données qui seront utilisées dans l’élaboration de modèles à l’échelle du paysage par des projets appuyés par le Programme d’intendance des espèces en péril. De multiples projets se sont axés sur la collecte de données qui peuvent être utilisées pour modéliser et prédire la répartition de l’espèce.
Des progrès continuent d’être accomplis dans le cadre des mesures 5 et 6 grâce aux efforts de gestion et de partage des données sur les espèces appuyés par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la LEVD.
Objectif : Maintenir la disponibilité d’un habitat adéquat pour le carcajou en Ontario en collaboration avec les collectivités et organisations autochtones et les parties prenantes.
- Mesure 8 – Poursuivre la mise en œuvre des orientations décrites pour le carcajou dans le Guide de gestion forestière pour la conservation de la biodiversité à l’échelle du peuplement et du site, qui peut être mis à jour périodiquement en fonction des meilleures informations disponibles.
- Mesure 9 – Travailler avec les collectivités et tous les secteurs pour mettre en œuvre, surveiller et rapporter les progrès accomplis dans le cadre de la Stratégie de l’Ontario en matière de changement climatique et du Plan d’action contre le changement climatique de l’Ontario pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
- Mesure 10 – Travailler conjointement avec les collectivités des Premières Nations du Grand Nord dans l’élaboration de plans communautaires d’aménagement du territoire afin de tenir compte de la faune, y compris du carcajou, et de déterminer les intérêts communautaires et à grande échelle qui reflètent la nature complexe de l’écologie, de la culture et de l’économie du Grand Nord.
- Mesure 11 – Protéger le carcajou et son habitat par l’entremise de la LEVD.
- Mesure 12 – Renseigner les autres organismes et autorités qui prennent part aux processus de planification et d’évaluation environnementales quant aux exigences de protection prévues à la LEVD.
Dans le cadre de cet objectif, des progrès ont été accomplis pour la mesure 8 grâce à l’application continue du Guide de gestion forestière pour la conservation de la biodiversité à l’échelle du peuplement et du site, y compris des articles clés relatifs à l’habitat du carcajou. Ce document demeure une ressource clé pour les gestionnaires forestiers de la province et, à ce jour, aucune mise à jour n’a été nécessaire pour les composantes axées sur le carcajou.
Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la mesure 9 par le biais des efforts déployés par la province pour atténuer le changement climatique et à la poursuite des travaux visant à élaborer et à adapter l’approche de l’Ontario en matière de gestion de cette question. L’Ontario a documenté une réduction des émissions de gaz à effet de serre depuis 2005 et a mis en œuvre un plan de lutte contre le changement climatique et de protection de l’air, des terres et de l’eau, qui contient des mesures clés afin de maintenir le cap.
Des progrès considérables ont été accomplis dans le cadre de la mesure 10 par l’amorce et l’élaboration de plans communautaires d’aménagement du territoire avec les collectivités des Premières Nations de l’Ontario. Les plans achevés à ce jour comprennent des éléments sur l’habitat du carcajou, et des travaux sont en cours pour tirer profit de ces réussites dans le cadre de l’élaboration de nouveaux plans avec d’autres communautés du Grand Nord.
Des progrès continuent d’être accomplis dans le cadre des mesures 11 et 12 grâce aux efforts d’autorisation, d’éducation et de surveillance mis en œuvre et appuyés par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la LEVD.
Objectif : Travailler en collaboration pour sensibiliser le public au carcajou et réduire les perceptions négatives et les menaces pesant sur l’espèce.
- Mesure 13 (hautement prioritaire) – Collaborer avec les trappeurs d’animaux à fourrure et les organisations qui représentent la communauté des trappeurs d’animaux à fourrure de l’Ontario afin de promouvoir des méthodes de piégeage qui réduisent les prises accidentelles de carcajou et les dommages connexes aux lignes de piégeage.
- Mesure 14 – Élaborer et offrir des produits de communication ciblés pour sensibiliser le public à l’espèce et réduire les perceptions négatives. Traduire les documents pertinents dans les dialectes de cri, d’ojibway et d’oji-cri.
Dans le cadre de cet objectif, des progrès considérables ont été accomplis dans la mise en œuvre de la mesure 13 grâce aux efforts de la FOGAF, du DNMRNF et de la WCS Canada pour la recherche et la promotion de pratiques exemplaires de gestion de piégeage des animaux à fourrure qui minimisent les préjudices causés au carcajou. Ces efforts ont également permis d’inclure dans le manuel d’instruction des trappeurs de l’Ontario des éléments visant à minimiser les préjudices causés au carcajou.
Des progrès ont été accomplis dans la réalisation de la mesure 14 grâce à de multiples projets du Programme d’intendance des espèces en péril axés sur la communication d’information sur le carcajou à une variété de publics. Les projets ont inclus la création de ressources éducatives multimédias, l’élaboration d’éléments de programmes d’études et la création de publications sur les espèces en voie de disparition pour les résidents des zones où le carcajou est présent.
Résumé des progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de rétablissement
L’objectif de rétablissement pour le carcajou est de maintenir la répartition actuelle en Ontario et de favoriser l’accroissement naturel de l’abondance et de l’aire de répartition de la population. Les efforts déployés vers l’accomplissement des mesures menées et appuyées par le gouvernement ont permis de réaliser des progrès vers l’atteinte de cet objectif. Par exemple, les efforts entrepris par les groupes de parties prenantes concernées, avec l’appui de la province, pour réduire au minimum la capture accidentelle de carcajous dans les lignes de piégeage, comprennent à la fois des travaux de recherche visant à mieux comprendre le problème et la publication de pratiques exemplaires de gestion pour aider à protéger le carcajou. De plus, les efforts continus de surveillance et de recherche ont permis d’obtenir des informations précieuses sur l’abondance et la répartition des populations de carcajous dans la province, ce qui permet de mieux suivre le statut de l’espèce et de reconnaître les zones qui pourraient nécessiter un soutien plus important afin de permettre l’augmentation naturelle des populations.
Le registre provincial d’observation démontre une large répartition du carcajou dans les zones d’habitat adéquat de la province. Les efforts accrus pour surveiller et documenter les occurrences de cette espèce depuis qu’elle a été inscrite sur la liste en 2004 ont donné lieu à des observations dans de nombreux nouveaux endroits. Ces données suggèrent une persistance dans la plupart des sites précédemment connus, ainsi qu’une expansion éventuelle de l’aire de répartition principale de l’espèce le long de sa périphérie orientale. Une augmentation continue et naturelle de l’aire de répartition du carcajou est conforme à l’objectif de rétablissement de cette espèce et suggère un progrès positif vers le rétablissement du carcajou en Ontario.
Recommandations
Conformément à la Déclaration, cet examen des progrès accomplis peut permettre de déterminer si des ajustements aux mesures qui y sont prévues sont nécessaires aux fins de protection et de rétablissement des espèces. Sur la base des progrès réalisés à ce jour, l’orientation générale fournie dans la Déclaration pour le carcajou, en particulier la mise en œuvre des mesures identifiées comme hautement prioritaires, devrait continuer à guider la protection et le rétablissement de l’espèce.
Bien que l’accent ait été mis sur la réalisation d’autres mesures, les mesures suivantes nécessitent un soutien supplémentaire pour aider à protéger et à rétablir les espèces :
- Mesure 1 (hautement prioritaire) – Procéder à l’inventaire et à la surveillance du carcajou, y compris l’intégration de la surveillance du carcajou aux programmes d’inventaire et de surveillance à grande échelle en cours (par exemple les relevés d’inventaire aérien des orignaux) et aux initiatives relatives aux espèces boréales en péril.
- Mesure 4 – Élaborer, tester et mettre à jour des modèles à l’échelle du paysage pour le carcajou en Ontario afin de mieux comprendre et de prévoir les changements futurs dans les déplacements et la répartition de l’espèce.
- Mesure 7 (hautement prioritaire) – Élaborer, mettre en œuvre et mettre à jour, au besoin, des pratiques exemplaires de gestion pour réduire les effets des activités de développement, comme l’exploitation minière, l’infrastructure et le développement énergétique, sur les tanières du carcajou et aux alentours.
- Mesure 10 – Travailler conjointement avec les collectivités des Premières Nations du Grand Nord dans l’élaboration de plans communautaires d’aménagement du territoire afin de tenir compte de la faune, y compris du carcajou, et de déterminer les intérêts communautaires et à grande échelle qui reflètent la nature complexe de l’écologie, de la culture et de l’économie du Grand Nord.
La protection et le rétablissement du carcajou continueront d’être une responsabilité partagée qui nécessitera la participation d’un grand nombre de particuliers, d’organismes et de collectivités. Un soutien financier à la mise en place des mesures pourrait être offert par l’intermédiaire du Programme d’intendance des espèces en péril. Le gouvernement pourrait aussi offrir des conseils sur l’éventuelle nécessité d’obtenir une autorisation en vertu de la LEVD ou d’autres lois avant d’entreprendre un projet. En travaillant ensemble, nous pourrons continuer d’accomplir des progrès dans la protection et le rétablissement du carcajou en Ontario.
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Une population est considérée comme historique si elle n’a pas fait l’objet d’un enregistrement au cours des 20 dernières années. Il peut arriver que les populations catégorisées comme historiques soient encore existantes, mais que les données dont on dispose actuellement ne permettent pas de le confirmer.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe L’aire de répartition potentielle de l’espèce est estimée selon une grille dont les carrés ont une superficie de 10 km2 chacun. Les carrés correspondent aux secteurs où des observations de l’espèce ont eu lieu. Cette superficie n’est pas représentative de l’étendue de l’habitat approprié de l’espèce ni de la superficie totale habitée par l’espèce.